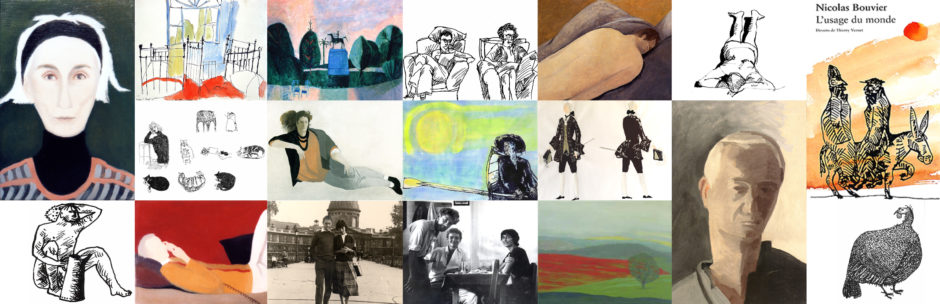Vous me demandez, mon ami, pourquoi je me suis installé à Paris et pourquoi j’y demeure. Je vous répondrai en homme de mon âge, qui avait 18 ans quand cette dernière guerre prit fin. Lors des premières échappées c’est à Paris que nous courions vérifier nos rêves. Chaque congé était l’occasion d’aller traîner de Stalingrad à Barbès, du Flore au Select, de Maubert à Jussieu. Pourquoi, ensuite, quand nous avons eu le privilège du choix de notre résidence, ne pas la fixer là où nous avions goûté nos émotion les plus fortes ?
Après une adolescence helvétique, une jeunesse vagabonde dont je croyais qu’elle avait connu tout ce qu’il y a à connaître du monde, je revins au bord du tiède Léman pour m’y enraciner et y fleurir. Mais je relis des notes d’alors : Octobre 57 : « …si les vaches décident d’être maigres et qu’il ne faut plus songer à voyager, autant s’installer ailleurs…il faut aller à Paris…je ne peux plus dormir, je suis trop heureux, Paris bientôt ». Mars 58 : « …lundi 17 nous partons. Je ne peux rien faire de bon ici. Je sens qu’à Paris enfin je vais sauter à pieds joints, je n’ai fait jusqu’à maintenant que prendre mon élan ». Mars 59 : « …Printemps adorable. Il y a un an nous débarquions, par un vent froid, à l’Hôtel de Londres, rue Bonaparte… Je suis un peu perdu, je ne sais plus dans quel sens travailler ».
Maintenant, automne 81, après dix ans passés entre les Folies-Bergère et le Grand Orient de France, et douze sur les hauteurs de Belleville, je ne peux que répéter : « Je suis un peu perdu, je ne sais plus dans quel sens travailler ». C’est cela : Paris est ville de perdition, d’égarement. On y vient pour ça : s’y perdre, égarer ce qu’on a acquis et trouver quelque chose au-delà, qu’on n’atteindra jamais, ou rencontrer enfin le Visage Unique au travers de l’épaisseur de la vie et dans cette lumière miraculeuse, marine et campagnarde… (Un souvenir : sur le Pont-Neuf, fin d’après-midi d’avril. Une vieille dame en voilette, le nez au ciel, les bras ouverts, contemple les nuages roses, de ce rose grisé qu’on ne voit que là)… qui pour un peintre est le premier attrait. Air gorgé d’eau. L’aquarelle règne, même dans le reflet de l’autobus sur les pavés humides et l’œil bleu de son conducteur. Rue Cadet nous habitions au fond d’une cour et, aidés d’un miroir qui captait le ciel pour le projeter sur le plafond, nous avons vécu dans l’ambre et le jaune sombre. Maintenant à Belleville nous naviguons dans le gris bleuté, les vapeurs qui traînent, l’espace racé. Quel bonheur !
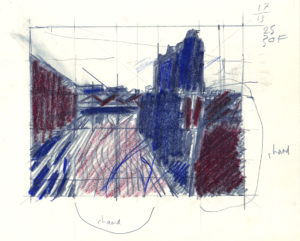
Croquis voie chemin de fer et gare Th.V.
Paris, ah ! Paris ! dit-on ; les nuits parisiennes, la consécration parisienne ! Excepté quelques rues, à dix heures du soir tout est bouclé comme à Clermont-Ferrand, et pour le reste je n’espère plus capter l’attention de ces regards distraits. En ce domaine, les désillusions viennent vite, la renommée ne se donnant qu’à ceux qui y sacrifient tous leurs instants. Le bruissement des élytres est assourdissant dans ce champ de cigales, vouloir le dominer est une entreprise essouflante. Un livre édité, un article paru, une exposition, produits au rythme naturel de la création, ne laisseront point de trace. On se lasserait d’être un navire sans sillage si, parfois, une rencontre insolite et capitale, une phrase éclairante, un encouragement fugace ne justifiait de s’être exténué. Chaque fois que je reviens à Paris, alors que le train s’étire au long de la grande courbe de Villeneuve-Saint-Georges (seul point du voyage d’où, sans se pencher de la fenêtre, on peut voir la locomotive) ou quand, de l’autoroute, sur la colline d’Arcueil, j’embrasse toute cette tartine offerte à ma voracité, chaque fois j’ai l’estomac serré d’angoisse : pourrai-je dévorer tout cela, vais-je être dévoré ? Cela dure quelques jours, mais après les téléphones aux amis, bonjour à Marcel et Mimi les épiciers du bas de la rue, salut à madame Juin la voisine d’en face, Paris se donne, c’est lui qui me porte, me nourrit, me console.
Quelle Ile au Trésor ! Pensez, tout ça ! Quelle variété ! A quoi que vous vous intéressiez, après peu d’effort d’investigation vous dénicherez une association de personnes qui partagent vos goûts, qui se réunissent, qui éditent une revue, qui ont composé des collections, un musée, qui se déchirent en luttes intestines et se divisent pour enrichir encore la culture générale. Et cela, du domaine philosophique au domaine gymnastique, du domaine historique au domaine ésotérique, scientifiques, philatélique, gastronomique, etc… Et les vastes bibliothèques aux employés en blouses grises, et les piscines bon et mauvais genre, et les églises où les piétés les plus fortes se concentrent, et les cafés pleins de comédies muettes, et le Louvre qui recèle le plus beau coup de pinceau de la peinture occidentale (perpétré par Zurbaran : un trait ample, aisé, souple, figurant le galon d’or de la robe de saint Bonaventure). Ce n’est pas pour cela qu’on est venu, mais c’est pour tout cela qu’on reste.
J’ai connu Paris avant la France. Paris polonais, yougoslave, maghrébin, italien, portugais. Plus tard j’ai compris que Paris était aussi Bordeaux, Nancy, Lyon et que les façades blanches et les toits gris étaient français, que Paris était une ville sur un méandre de la Seine. Il y a Paris cosmopolite qui vous attrape le cœur et Paris français qu’on aime autant, qui se donne plus secrètement, se révèle plus lentement. (Souvent à table. Trois souvenirs : un dîner dans un restaurant du Quai Voltaire, boiseries claires et nappes blanches, parler pointu et idées fines ; un peu de champagne dans le bureau de Maurice Escande, alors administrateur de la comédie Française, le plus charmant homme que la terre ait porté (par la fenêtre les taxis et les réverbères) ; une blanquette de veau partagée avec des amis menuisiers de Belleville. Du français affiné par Paris.)
Paris est un vaste champ ouvert à la liberté obligatoire ; il n’y a qu’une façon d’y survivre, d’y éviter l’écrasement, c’est d’être tout bonnement ce que l’on est. Paris l’apprend à chacun. Dans le métier de peintre la multiplicité des façons de peindre vous y condamne, dans le métier d’homme la multitude des façons de vivre vous y encourage. Etre un poisson différent dans ce vaste aquarium n’est pas inattendu et point n’est besoin ici pour éprouver sont identité d’avoir recours à la rébellion hirsute ou au flou alcoolique.
Si tout est à peindre parce que tout baigne dans cette lumière sensuelle qui révèle l’inimitable velouté de l’air, tout est à écrire aussi parce que tout événement s’amplifie dans la curiosité générale, l’indiscrétion, le goût des passions, la vie fortement vécue : bref, ici tout est romanesque. Mais, mon ami, après tout, en y songeant, je réalise que je trouverais sans doute à New York ou à Tokyo ce que je suis venu chercher ici, à savoir dix millions d’êtres humains trottant au même endroit et faisant naître par leur frottement une chaleur à laquelle leurs masques fondent. Voilà, c’est cela qu’offre une très grande ville : des visages dans leur vérité, épurés par le risque. C’est cela dont un peintre a besoin par-dessus tout : des choses dans leur vérité, car sinon comment pourrait-il la dire à ceux qui l’attendent de lui ?
P-S : Le Suisse de Paris est exotique, le peintre suisse plus encore. Son pantalon reste taché d’un peu de vert pâturage ; quelques mammifères cornus et velus veillent dans un coin de son âme ; quelques haies griffues, quelques cailloux un peu lourds handicapent l’agilité de ses réparties et l’amplitude de ses audaces ; un résidu d’innocence lacustre le désarme face aux malices du labyrinthe et le dissuade de quelques bassesses.
La Suisse est à deux pas, le Suisse y retourne souvent. Rares sont ceux qui l’ont quittée à jamais. J’en connais peu, je n’en suis pas. Tout le bien que je dis de Paris n’est pas autant de mal que je dirais de la Suisse qui a des charmes et des agréments dont je ne voudrais pas être privé, dont, entre autres, le goût de l’intimité, les dons de l’attention et de la patience, le sens de la densité des heures : toutes irremplaçables vertus agricoles qui pâtissent du bitume par ailleurs si gratifiant.